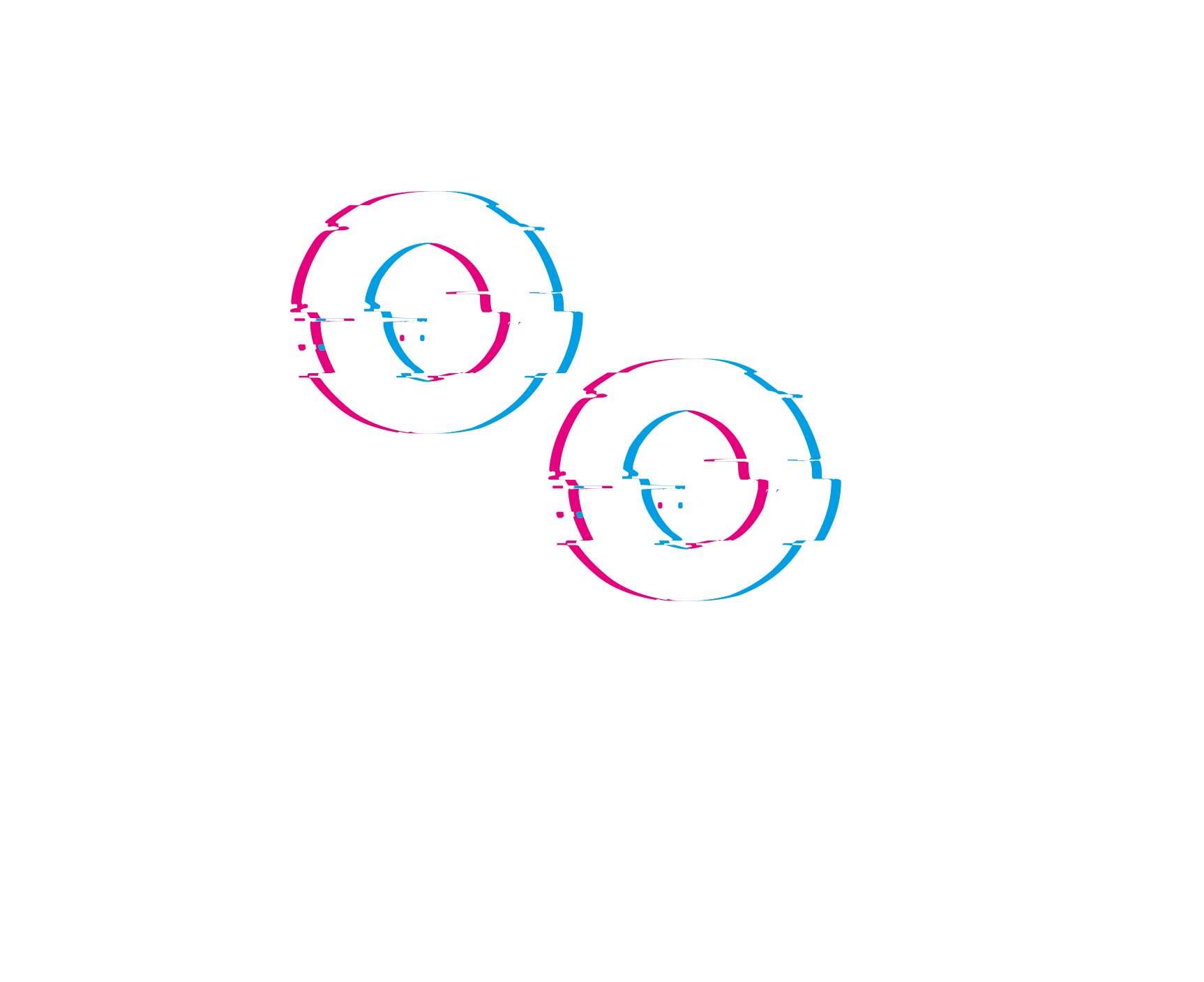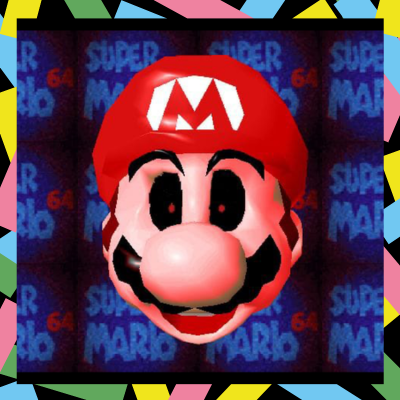Il y a des séries qui nous rappellent une époque. Et puis il y a Girls, qui nous rappelle un âge.
Icône des années 2010, souvent étiquetée “générationnelle”, la série de Lena Dunham raconte surtout quelque chose de plus vaste et intemporel : le trouble de l’entrée dans l’âge adulte. Cette zone floue, entre exaltation et chaos, où l’on essaie de se définir tout en se perdant un peu plus. Ce moment suspendu, entre la fin de l’insouciance et le début des responsabilités (maintenant c’est toi en face to face avec ton médecin lol). Ce que Girls capture, ce n’est pas simplement la culture millennial (Tumblr, les colocs à Brooklyn et les selfies filtre sépia #lifeisajooooke) c’est l’expérience universelle d’avoir vingt-cinq ans. Celle qui traverse les générations. Celle qui reste, même quand les références changent, même quand les plateformes évoluent.
Aujourd’hui, on aime dire que la Gen Z vit une vingtaine radicalement différente : plus précaire, plus digitalisée, plus politisée, plus anxieuse. Que les réseaux sociaux ont tout changé, que l’ambition s’est transformée, que l’amour se swipe, que l’identité se performe. Tout cela est vrai, en partie. Mais en réalité, qu’on ait 25 ans en 1995, en 2015 ou en 2025, on y retrouve toujours les mêmes motifs : le sentiment d’imposture, la peur de rater sa vie, l’envie d’être unique, le besoin de reconnaissance, les premières désillusions, les amitiés fondatrices, les ruptures qui bouleversent plus qu’on ne l’admet. La vingtaine est un passage, pas une époque, et ses rites, excès, vertiges ne changent presque pas. Girls, avec ses références très datées (et Adam Driver torse nu 95% du temps 😉), reste incroyablement pertinente parce qu’elle parle davantage de l’âge de ses personnages plutôt que de l’époque. Elle nous montre qu’être paumé #Jessa, hypersensible #Shoshanna, autocentré #Hannah, ce n’est pas un symptôme générationnel : c’est un moment existentiel. (Disclaimer : moment pouvant durer entre 2 et 10 ans, selon votre pedigree.)
La société adore théoriser des césures générationnelles : Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z… On les oppose, on les caricature, on en fait des slogans. C’est plus simple et vendeur, mais à force de souligner les différences, on oublie ce qui relie les vingtenaires.
Il y a un confort à penser que “nous” sommes uniques (oups on donne raison à ceux qui le pensent très fort). Mais il y a une forme de maturité à reconnaître que “nous” sommes aussi un peu les mêmes, face aux mêmes angoisses déguisées autrement. Chaque génération réinvente son langage, ses codes, sa manière d’habiter le monde, mais pas forcément les dilemmes qui les traversent. En ce sens, Girls ne parle pas qu’aux Millennials. Elle parle à tous ceux qui, un jour, ont eu 25 ans et se sont sentis à la fois trop grands et pas assez solides. Elle restera une référence tant qu’il y aura des jeunes adultes pour se cogner aux murs du réel, pour rêver trop fort, pour espérer être aimés un peu mieux.