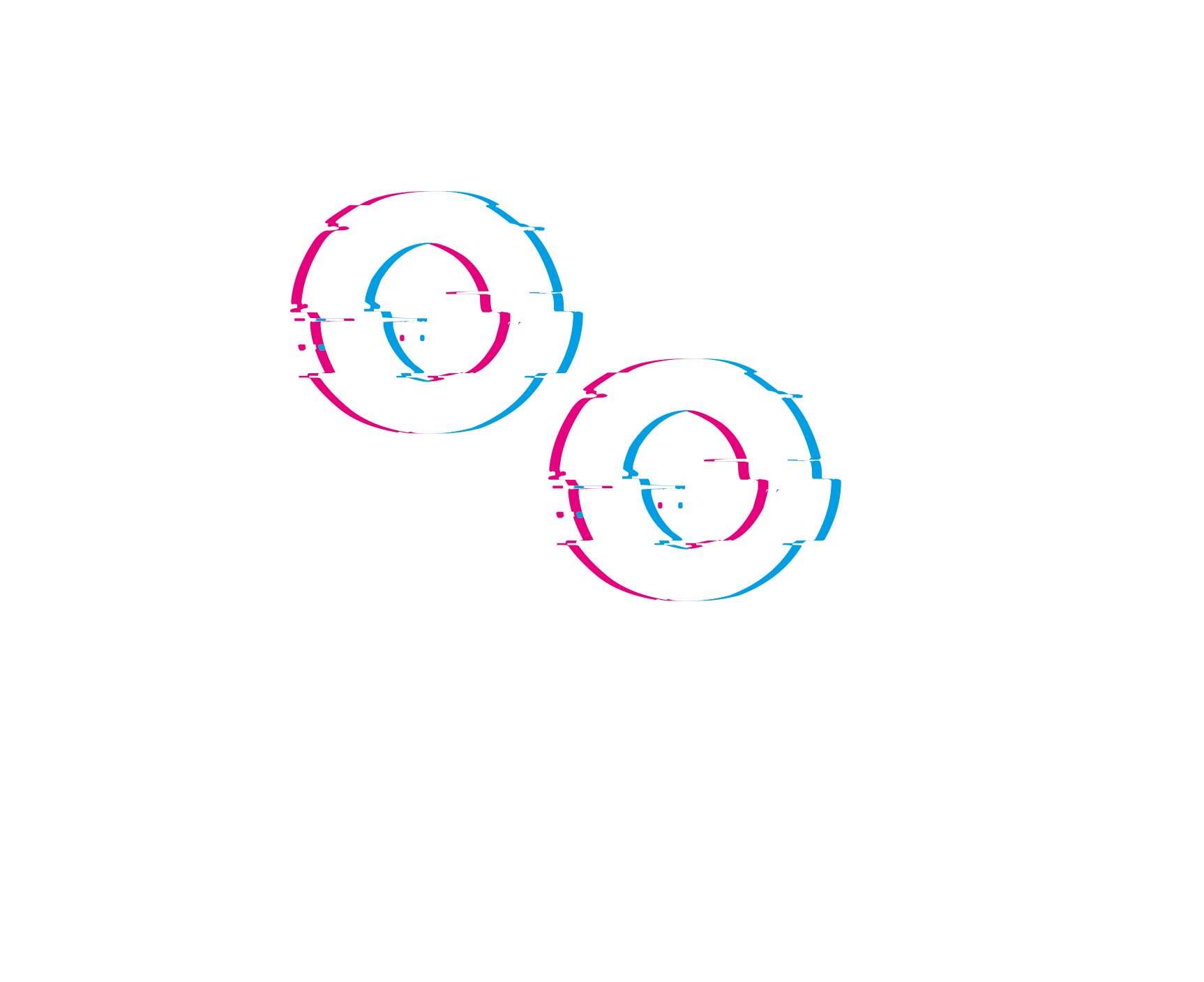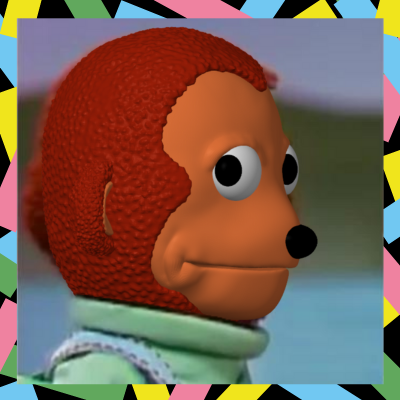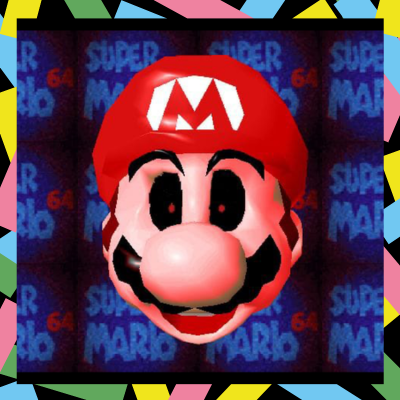Cette semaine on est tombé sur une actu pour la moins étonnante : certaines universités proposent à leurs étudiants de suivre des « cringe studies », c’est-à-dire, des cours qui étudient le phénomène de la « gêne », comme nouveau rapport au monde.
Si l’info peut paraître anecdotique comme ça, avec les Zoomers on s’est dit que ça témoignait d’une réelle évolution sociétale : aujourd’hui les gens – et surtout les jeunes – sont tous, tout le temps, « cringés ». D’ailleurs, si on regarde l’évolution du nombre de recherches associées aux mots clés « gênant », « malaisant » et « cringe », il n’a cessé d’augmenter depuis les années 2010 sur Google Trends.
Comment ça s’explique ? Dans son essai Awkwardness, la philosophe Alexandra Plakias explique que jusqu’au début du XXe siècle la religion établissait des règles très strictes sur les comportements à suivre et les normes sociales à respecter. Avec la laïcisation et l’ouverture culturelle de la société, les normes se sont progressivement assouplies et multipliées. Et oui, force est de constater qu’on évolue dans des environnements de moins en moins formalisés (ex : management friendly au travail), où la place du choix est toujours plus importante (on est libre de s’habiller, de rire ou d’aimer qui on veut). Si cette ouverture des champs des possibles constitue un enrichissement précieux, ça crée aussi de nouvelles possibilités de malaises car, en fonction de la situation, les normes peuvent parfois entrer en conflit. Par exemple, qui ne s’est pas déjà demandé s’il devait tutoyer ou vouvoyer son supérieur ? Les attentes concernant les règles de civilité en entreprise peuvent être tellement différentes en fonction du secteur, de l’âge de la personne en face, de sa culture, que les situations gênantes peuvent assez vite advenir. Et puis, on va pas se mentir, les réseaux sociaux ont également largement contribué à démocratiser le sentiment de gêne. D’abord parce que comme on est systématiquement en train de s’observer, on est plus à même de se gêner. Et puis parce que la gêne est devenue un outil d’engagement et de viralité sur les réseaux : il suffit de regarder le succès des comptes comme cringechub, cringe_gouv ou des trends tiktok dédiées comme #Trynottocringechallenge qui regroupe plus de 336 millions de posts.
MAIS le problème c’est que, sur les réseaux, ce n’est pas la gêne en tant que telle qui crée de l’engagement. C’est souvent une gêne qui répond à une logique d’humiliation et qui décrédibilise des causes dites « progressistes ». Un article d’Usbek et Rica sur le sujet prend l’exemple de Calvin Lee Vail, un youtubeur américain qui se moquait ouvertement des féministes, des défenseurs de l’environnement, de la justice sociale ou encore des personnes transgenre, les qualifiant à chaque fois d’individus « trop bizarres » à la voix « trop aiguë » et aux cheveux « mal coiffés ».
Mais on n’est pas condamné à laisser prospérer ce genre de contenus !
En fait, avec les Zoomers, on voit même une opportunité se dessiner : dans un monde où les remarques racistes, antisémites et sexistes sont de plus en plus banalisées tant elles circulent en toute impunité sur les réseaux, on pourrait – en plus de saisir la justice – utiliser le « cringe » pour renverser le malaise. C’est-à-dire, rendre gênant les propos ou comportements problématiques des internautes pour dissuader les autres à faire de même.